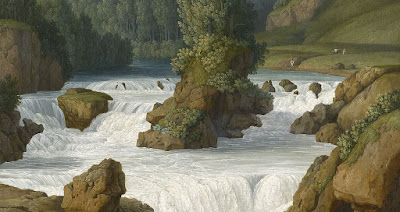Trafalgar Square est certainement la plus célèbre place de l'Empire britannique.
Au centre de Londres, elle est consacrée à la mémoire du vice-amiral Nelson, qui a, lors de la bataille navale de Trafalgar, sauvé le Royaume de la convoitise compulsive de Napoléon Bonaparte et reçu le jour même un
coup de mousqueton définitif tiré par un félon embusqué sur la hune d'un vaisseau français, et qui le transperça. C'était le 21 octobre 1805.
Depuis 1843, en grès, il surplombe de plus de 50 mètres l'agitation des londoniens au sommet d'une imposante colonne au cœur de Trafalgar Square.
Et comme la plupart des carrés (squares) au Royaume-Uni, la
place Trafalgar est pourvue de quatre coins. Chacun est garni d'un majestueux piédestal destiné à recevoir l'effigie d'un héros national.
Le roi
George 4 fut le premier à bénéficier d'un de ces piédestaux. Cultivé, inadapté à son poste de roi et excessivement prodigue il avait commandité sa propre
statue équestre en gloire et en bronze.
À sa mort peu après, en 1830, alcoolique, opiomane et obèse, on a dit de lui qu'aucun roi défunt ne pourrait être aussi peu regretté de ses contemporains.
En 1840, quand la place Trafalgar fut presque achevée, on déposa sa statue, temporairement disait-on, sur le socle nord-est. Elle y est encore.
Le
général Napier, en bronze, eut droit au socle sud-ouest en 1856. Mort depuis trois ans, il avait beaucoup œuvré pour la colonisation de l'Inde, l'expansion frénétique de l'Empire britannique et la diffusion de la civilisation anglaise.
Le
général Havelock, en bronze également, hérita du socle sud-est en 1861. Il était mort de dysenterie quatre ans auparavant. Très pieux et chrétien, il s'était distingué aux confins de l'empire colonial par la distribution de bibles à ses soldats, entre deux assauts victorieux contre les rébellions déloyales à la couronne britannique.
En 2000 le maire de Londres, argüant le constat qu'aucun londonien d'aujourd'hui ne connaissait ces deux généraux célèbres,
suggéra sans succès de les éloigner vers la Tamise et de leur substituer des personnalités plus appropriées.

Londres, Trafalgar square, avec au premier plan le quatrième socle devant la colonne de Nelson.
Il restait donc le quatrième socle (the fourth plinth), au nord-ouest, qu'on ne parvenait pas à meubler. On avait bien eu l'intention d'y poser le roi William 4, successeur de George 4 et mort en 1837. Mais personne n'était arrivé à en organiser le financement.
Déduction faite de l’inoxydable Nelson, la nation anglaise n’avait-elle donc pas plus de trois personnalités illustres susceptibles de rassembler suffisamment de bienfaiteurs fortunés ?
Hélas, le
quatrième socle demeura inoccupé pendant 159 ans.
Et on le pensait vacant à jamais, abandonné aux pigeons et aux exhibitionnistes assez téméraires pour braver les policemen, quand la très officielle Société royale d’encouragement des arts (
RSA) proposa en 1998 de l’utiliser comme lieu d’exposition de sculptures monumentales modernes.
Dès lors, après quelques essais et atermoiements, le socle nord-ouest de la place Trafalgar est devenu à compter de 2005 le support régulier d’exhibitions d’œuvres contemporaines sculptées.
Ainsi la statue équestre d’Elmgreen et Dragset
(illustration ci-dessus) intitulée «
Powerless Structures, Fig. 101 », et figurant un enfant sur un cheval de bois en bronze, a trôné d’avril 2012 à avril 2013. Elle succédait au
pittoresque «
vaisseau de Nelson dans une bouteille » de Yinka Shonibare (de mai 2010 à janvier 2012), et précédait l’actuel «
Hahn/Cock » de Katharina Fritsch qui représente un
immense coq uniformément bleu et très discuté, le gallinacé symbolisant le peuple français aux yeux de certains patriotes insulaires.
On notera peut-être que les
sculptures élues pour ce quatrième socle ont été jusqu'à présent remarquables moins par leur style invariablement plat et académique, et leur pesanteur symbolique, que par leur délicieuse incongruité et le plaisir enfantin de découvrir de tels objets quotidiens mais aux dimensions démesurées, siégeant sur un haut piédestal au milieu d'une place anglaise légendaire, sévère et grise.
Mise à jour : Le 5 mars 2015, le squelette de cheval « Gift horse » de Hans Haacke a détrôné le coq bleu sur le quatrième socle.